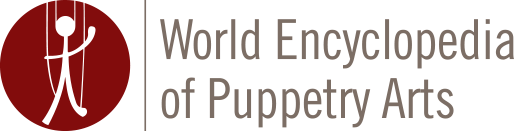Selon l’étymologie, l’automate (du grec automatos, « qui se meut lui-même ») présente un caractère prodigieux. À la différence des autres êtres artificiels, mus par une force extérieure, l’automate présenterait une vie propre et, indépendamment de ses fonctions et de ses mécanismes (cachés), renverrait toujours à la notion de merveilleux. Dans l’Antiquité, l’automate présentait ce double aspect relevant à la fois du prodige divin et de la machine scénique. L’expression deus ex machina signifie littéralement un « dieu apparaissant au moyen d’une machine » et désigne ce procédé de la dramaturgie grecque puis classique qui devait dénouer « miraculeusement » le drame sans révéler les principes ou les mécanismes de son apparition.
L’idée de dispositif automatique et la notion de spectacle se rejoignent déjà ici avant que cette union ne donne ses fruits des siècles plus tard dans les grandes machineries baroques. Dans la Métaphysique, Aristote désigne par thaumata, ces merveilles automatiques capables de susciter la surprise et la réflexion philosophique tandis que la métaphore philosophique de l’organisme « mécanique » et de l’idée d’un homme mû par des cordes élastiques (neura, les « nerfs »), les passions, apparaît chez Platon. L’anatomiste Érasistrate (IIIe siècle av. J.-C.) voyait l’homme comme une machine actionnée selon le système pneumatique où le cœur constituerait la source de réchauffement. Le développement de la « pneumatique » qui exploitait les propriétés des fluides en mouvement, de la vapeur et de l’air comprimé (également grâce au réchauffement par le feu) rendait possible la conception de petits dispositifs mécaniques, ces « merveilles » que l’on pouvait trouver à l’époque hellénistique et romaine. Si, à Delphes, les statues animées appartenaient encore au domaine religieux, au Ier siècle apr. J.-C., Héron d’Alexandrie offrit dans son traité sur les automates (Automata) le premier exemple de théâtre mécanique, un dispositif à base fixe avec des figures raffinées mues par des roues et des cylindres actionnés grâce au mouvement du sable – selon le principe de la clepsydre – prélude aux grandes inventions de la Renaissance. Ce traité fut d’ailleurs traduit par Bernardino Baldi en 1589 tandis qu’en 1588 parut le premier livre sur les automates de l’ère moderne : Le Diverse et Artificiose Macchine (Les Machines diverses et artificieuses) d’Agostino Ramelli. Il faut enfin rappeler que le mot grec thaumatopoios (ainsi que thaumatourgos), qui signifiait « celui qui fait des tours d’adresse » a même été traduit par « montreur de marionnettes », le mot donnant à l’époque chrétienne thaumaturge, « celui qui fait des miracles ». La construction d’androïdes, d’automates ou de figures mécaniques anthropomorphes cache ainsi, dès les origines, l’aspiration de l’homme à se mesurer, dans un esprit d’émulation, au Dieu créateur.
Avant même de se manifester dans l’histoire, cette ambition est présente dans le mythe, avec Dédale inventeur de la première « machine volante » ou Héphaïstos/Vulcain, forgeron de Zeus et créateur du géant de bronze Talos. Les statues mobiles de l’Égypte ancienne relevaient aussi du simulacre divin (voir Égypte). L’âme de la statue, le souffle divin qui la mouvait, était appelée ka.
Du Moyen Âge au XVIIe siècle
Au Moyen Âge parvinrent en Europe et en particulier en Sicile – où la diffusion d’un traité sur les « mécanismes ingénieux » du savant arabe Al-Jazari fut déterminante au XIIIe siècle – des animaux d’un grand raffinement destinés à orner les jardins. Parmi ceux-ci, figuraient des oiseaux chanteurs mécaniques, ancêtres des animaux artificiels qui ornèrent les jardins de la Renaissance et les jardins baroques. De nouveau, le mythe et la littérature amplifièrent les prodiges de la technique : dans l’Hypnerotomachia Poliphili (Le Songe de Poliphile) de Francesco Colonna (1499), Poliphile est « assailli » par un jet d’eau sortant d’une statue dans un jardin thermal où il croise de curieux appareils hydrauliques mobiles et sonores, les mêmes, aujourd’hui perdus, qui stupéfièrent les visiteurs (parmi lesquels Montaigne en 1580) de la villa de Pratolino (1569). Ces mécanismes furent imités dans d’autres jardins d’Europe, par exemple à Hellbrunn, près de Salzbourg, dans un ensemble qui remonte au début du XVIIe siècle, enrichi d’un théâtre mécanique au milieu du XVIIIe siècle. De nombreuses figures mues par un système hydraulique y mettaient en scène le spectacle mécanique d’une nature recréée tandis que des grottes y abritaient personnages mythiques et animaux artificiels.
Aux XVIe et XVIIe siècles, des appareillages automoteurs faisaient également partie de l’apparat dont s’entouraient les princes et les nobles : lions, homards, tortues mobiles, danseurs, personnages mythologiques, crèches mécaniques, chars triomphants, oiseaux volants ou gazouillants, horloges musicales formaient cet ensemble d’objets divers que l’on retrouva souvent dans les Wundernkammern ou cabinets de curiosités. Tout autres sont en revanche les figures plus familières des jacquemarts : ces hommes de fer battant les heures, qui scandaient le temps humain sur les églises et les beffrois, n’entrent pas dans cette catégorie du merveilleux. La représentation sacrée (par exemple dans l’Assomption de Dieppe, de 1443 à 1647, voir France) utilisa également des figurines mécaniques, tandis qu’à l’époque baroque remontent les premières tentatives de créer de la musique automatique avec Giovambattista Della Porta (1535-1615), Athanasius Kircher (1601-1680) ou Kaspar Schott (1608-1666).
C’est à la Renaissance également que furent réalisées des anatomies mobiles (par exemple, celles en cire comme le Scorticato (L’Écorché) de Lodovico Cardi, dit Cigoli, 1598). À la fin du XVIIe siècle, l’anatomiste Lorenzo Bellini expliquait le fonctionnement de l’appareil ostéo-articulaire en le comparant à celui des théâtres mécaniques et en citant à cet effet les machines hydrauliques de la villa de Pratolino. Si l’on reste ici dans le domaine de la connaissance scientifique – qui peut d’ailleurs avoir une dimension spectaculaire comme en témoigne l’expression « théâtre d’anatomie » – on n’est jamais loin du mythe littéraire, comme le démontre la fortune de l’homunculus de Paracelse (1493-1541) jusqu’au Faust de Goethe.
L’âge d’or des automates : XVIIIe et XIXe siècles
C’est au XVIIIe siècle que cette soif de connaissance de l’homme comme machine (et de son dépassement grâce à des structures artificielles) trouva son expression la plus élaborée dans de nombreux écrits, des recherches sur le fonctionnement des artères aux études du médecin et philosophe Julien Offray de La Mettrie (1709-1751). Pour l’auteur de L’Homme machine (1748), l’âme, une « hypothèse inutile », adhère entièrement aux organes du corps et l’homme est un ensemble de ressorts qui se remontent automatiquement, où chaque fibre se meut involontairement d’elle-même. La Mettrie dote la matière de sensibilité, tendant ainsi à annuler le fossé traditionnel entre celle-ci et la pensée. Cette idée est essentielle dans l’histoire des études sur l’homme en tant que « mécanisme » et laisse filtrer l’aspiration à une conception unifiée de l’homme, ouvrant la voie au matérialisme.
C’est aussi au XVIIIe siècle que la science et la technique furent utilisées à des fins ludiques et divertissantes dans la fabrication d’androïdes, des créatures de Jacques de Vaucanson (1709-1782, le Canard, le Tambour, le Flûtiste imitant dans les détails le fonctionnement organique) aux tableaux mécaniques en vogue en France (paysages avec des figures en mouvement, artisans et mages doués de parole) jusqu’aux figures de Pierre Jaquet-Droz (1721-1790) et Henri-Louis Jaquet-Droz (1752-1791), autour de 1770. Le Musicien, l’Écrivain public, le Dessinateur reproduisant mécaniquement des tâches humaines, étaient alors présentés dans de nombreux pays d’Europe à un public prêt à payer pour admirer de telles merveilles. Dans ces acteurs mécaniques présentés par des « montreurs-imprésarios », on retrouvait cet univers merveilleux mais rehaussé par les prodiges d’une technique capable de reproduire le réel. En témoigne de manière éclatante le Canard de Vaucanson présenté en 1738, extraordinaire imitation non seulement des mouvements de l’animal mais également de ses fonctions puisqu’il mangeait et « digérait » la nourriture engloutie. Cette démonstration fit tant de bruit qu’elle provoqua même des débats très sérieux sur le processus de la digestion jusqu’à ce que le « truc » de l’habile constructeur soit révélé : la nourriture n’était pas transformée mais occultée dans une boîte intérieure. Il est remarquable qu’au XIXe siècle, le Canard de Vaucanson ait été restauré par l’illusionniste Jean Eugène Robert-Houdin (1805-1871) qui incarna bien cette conjugaison entre une technique raffinée et le tour spectaculaire.
Imitation et dépassement de l’humain, l’automate, comme d’autres figures artificielles, joue sur ces deux possibilités. Alors que l’approche technologique donne l’illusion d’une supériorité de l’humain, l’art voit dans l’automate un potentiel surhumain plein de fascination et de danger. En plein siècle des Lumières, les plus importants constructeurs d’automates léguèrent au romantisme le caractère imaginaire, démoniaque et surnaturel de leurs créatures. Le « Turc » de Wolfgang von Kempelen présenté à la cour de Vienne en 1790, en est un cas exemplaire : il s’agissait d’un faux automate, d’un joueur d’échecs extraordinaire alliant une mécanique sophistiquée et une subtile mise en scène utilisant les pratiques gestuelles et les effets techniques de lumière existant à l’époque. Le spectacle hypnotisa le spectateur qui ne se doutait pas que la machine dissimulait un être humain et laissait même planer un doute quant à la mystérieuse « intelligence » de cet être artificiel. Les romantiques en recueillirent ainsi l’aspect inquiétant et démoniaque : pour Edgar Allan Poe, qui le vit en 1836 présenté par Maelzel, l’impression d’un mécanisme livré à lui-même était créée par les dimensions et par les traits grossiers du Turc qui, s’il avait été une imitation parfaite d’un homme, n’aurait certainement pas produit le même effet.
Une dimension poétique et théâtrale marque les spectacles d’automates, qui captivaient les regards et l’imagination, et restèrent fort en vogue jusqu’au milieu du XIXe siècle. Il s’agissait souvent des figures du spectacle comme des danseurs, des Pierrots, des clowns, des acrobates ou des musiciens. George Sand, dans son article sur Le Théâtre des marionnettes de Nohant (1876), raconte avoir vu à Venise (en 1834) « des drames de chevalerie exécutés par de merveilleux automates ». Le spectacle était donné sur une place : « C’était de savantes petites machines, des chevaliers d’une coudée de haut se livrant à des combats équestres, des dames ruisselantes d’or et de pierreries donnant le prix au vainqueur, des pages sonnant du cor sur le haut des tours. » Un texte accompagnait la démonstration, des vers du Tasse ou de l’Arioste « braillés dans la baraque pour expliquer l’action ».
La littérature romantique, puis symboliste développa le mythe de l’automate et de la créature artificielle dans des tonalités fantastiques et ésotériques, depuis Jean-Paul avec son « homme des machines » (Palingenesis, 1798) et E. T. A. Hoffmann (Die Automate Les Automates, 1814 ; Der Sandmann L’Homme au sable, 1817, avec son Olympia mécanique) jusqu’à Villiers de L’Isle-Adam (L’Ève future, 1886).
Le mythe littéraire entre ainsi en résonance avec la légende réelle. Les plus célèbres automates du XIXe siècle furent sans doute ceux de Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871). Fils d’horloger, fasciné par les mécanismes, il restaura le Canard de Vaucanson, comme on l’a vu, ainsi que d’autres automates anciens, mais surtout il en créa lui-même et, dans son théâtre, donna des « Soirées fantastiques » où l’on pouvait voir des numéros d’illusionnisme, des marionnettes à fils et ses automates : l’Escamoteur, le Danseur de corde, l’Oiseau chantant, etc. La réputation de Robert-Houdin fut telle qu’une légende se développa au point qu’il fut envoyé en Afrique du Nord pour ruiner le crédit des marabouts grâce à ses « pouvoirs » supérieurs.
Les automates à l’ère industrielle
Au cours du XIXe siècle, les automates entrèrent dans l’ère industrielle et leur fonction ludique l’emporta. À la différence des grandes créations du siècle précédent, ils furent désormais produits en série, souvent pour l’usage privé (associés à des boîtes à musique) et réduits à des machines passives. Par ailleurs, d’autres automates, « fonctionnels », opposaient l’utilitarisme à l’imagination mais parfois avec des revers inquiétants. Si, dans Frankenstein (1818) de Mary Shelley, la rébellion du fils artificiel contre le père mettait déjà en jeu le rapport destructif entre le créateur et sa créature, avec l’affirmation de la société industrielle et les progrès techniques, l’automate devint le vecteur d’une force dangereuse, l’héritier du Golem qui – ce n’est pas un hasard – connut un nouvelle fortune avec le livre de Gustav Meyrink en 1915 et avec les cinéastes expressionnistes (voir Cinéma).
Apparut alors le robot. Issu d’un mot tchèque (robotnik : travailleur), cet être naquit sous la plume de Karel Čapek dans sa pièce RUR (Robots universels de Rossum), créée au Théâtre national de Prague en 1921. Doués de sensibilité, ces robots en révolte (ce thème apparaît aussi chez Romain Rolland dans La Révolte des machines, 1921) étaient loin de posséder la grâce des automates du XVIIIe siècle ; ils héritaient plutôt de l’androïde inquiétant du romantisme, à l’image du personnage de Maria créé par le savant fou Rotwang pour semer la discorde parmi les travailleurs dans le film Metropolis (1926) de Fritz Lang. Le rapport entre organique et artificiel devint plus inquiétant (à travers le thème de la dépossession de la personnalité par des doubles, par exemple) dans les œuvres contemporaines. Mais le modèle « mécanique » présenta aussi dans la première moitié du XXe siècle un trait positif lorsqu’étaient mis en avant le rythme, la mesure et la dynamique qui libèrent la force joyeuse et vitale comme dans le merveilleux futuriste ou même dans la biomécanique de Meyerhold et surtout dans le groupe d’avant-garde russe FEKS (Fabrique de l’acteur excentrique) des années vingt. L’exaltation de la communication de masse et de la machine exploitait le procédé du montage et le principe du mouvement nécessaire : la tâche de l’acteur FEKS consistant à rejeter tout ce qui est superflu, encombrant et inutile à la réalisation du but, elle avait comme résultat des mouvements proches de ceux de l’automate. La déformation grotesque de l’humain dans sa forme mécanique apparut aussi dans d’autres mouvements artistiques. La technique du montage (utilisée par Arthur Schnitzler, Oskar Kokoschka, Yvan Goll ou le mouvement Dada), dans la littérature comme au théâtre, représenta le procédé formel le plus remarquable, marqué par l’idée d’être artificiel, qui peut être assemblé à discrétion, indépendamment d’un ordre logique ou séquentiel. Même la structure dramatique devint ainsi « automatique », schéma que l’on retrouve dans les Impressions d’Afrique (1910) de Raymond Roussel, sans oublier l’apport des surréalistes et de l’écriture automatique où réapparaissent l’imaginaire et l’inconscient, des traits caractéristiques de l’univers des automates qui avaient été éclipsés.
La scène contemporaine
L’ambition des automates n’est pas seulement d’imiter l’apparence et les mouvements des créatures vivantes, mais de recréer leurs fonctions et leurs capacités. C’est cela qui fascinait dans le Canard de Vaucanson ou dans le faux Turc de Kempelen, c’est cela qui suscita au XXe siècle les robots industriels puis les recherches sur la cybernétique et sur l’intelligence artificielle. Dans le domaine spectaculaire, l’électronique, les systèmes aléatoires et les machines auto-éduquées permirent de figurer et de mettre en « œuvre » quelque chose qui évoque, ne serait-ce qu’illusoirement, les incertitudes du réel et la « liberté » des comportements. Jacques Monestier construisit entre 1975 et 1979 un de ses plus célèbres automates, celui du Quartier de l’Horloge, près du centre Pompidou à Paris. Cette horloge animée, en laiton et en bronze pèse une tonne et mesure 4 mètres de haut. Elle représente Le Défenseur du Temps en lutte avec un dragon, un crabe et un coq symbolisant la terre, la mer et le ciel. L’œuvre est réglée par un programmateur de hasard, et l’horloge-mère électronique commande le mouvement des aiguilles ainsi que six programmateurs à cames, des magnétophones qui sonorisent la respiration du dragon, ses grondements, le bruit des vagues, le souffle du vent. Le Défenseur du Temps s’anime grâce à des vérins pneumatiques pour combattre ces animaux menaçants qui l’attaquent d’une façon aléatoire. Jacques Monestier a réalisé aussi pour le Festival de marionnettes de Charleville-Mézières, Le Grand Marionnettiste.
Dans un autre registre, Nicolas Schöffer explora dès 1948 l’espace (spatio-dynamisme), en 1956, la lumière (lumino-dynamisme) et en 1960, le temps (chrono-dynamisme). Il créa des sculptures dont les cycles d’animation étaient commandés par l’un ou l’autre de ces paramètres. Nicolas Schöffer parvint ainsi à la dématérialisation privilégiant le comportement de l’œuvre en fonction de son environnement, la mettant au niveau d’une création permanente par l’alternance programmée des perturbations et un rééquilibrage de ces processus. Il faut aussi citer Jean Tinguely, créateur de spectaculaires sculptures animées, de ferrailles et matériaux divers. Meta-Matic 17 tourna sur le péristyle du musée d’Art moderne lors de la première Biennale de Paris, en 1959. Cet automate « automobile, odorant et sonore » était une machine à dessiner sur roues qui débitait des calligrammes tracés par un pinceau fou, automatique et aléatoire. 40 000 peintures s’envolèrent derrière cet artiste mécanique. En 1960, Tingely conçut Va et vient, assemblage mécanique équipé d’un moteur et d’un contrepoids puis alla jusqu’à créer des machines-suicides, explosives et autodestructibles. On connaît bien ses mécaniques accompagnées des sculptures bariolées de sa compagne Niki de Saint-Phalle. Mus par la pression de l’eau, ces automates s’éclaboussent dans le bassin de la place Igor Stravinsky près du centre Pompidou à Paris. Ces recherches esthétiques peuvent être rapprochées de celles de Harry Kramer qui présenta au festival de Brunswick en 1957 son Théâtre mécanique. Quant à Denis Pondruel (né en 1949), il tenta par ses expérimentations d’échapper à ce qu’il appelait le « théâtre-horloge » pour se rapprocher du théâtre « bombe », dans les parages d’un théâtre de l’objet, non figuratif, portant toute son attention aux comportements. En décembre 1980, il présenta ainsi Le Cid, au centre d’action culturelle de Cergy-Pontoise dans une étrange mise en scène. Sur une longue table métallique reposait un chemin de rouleaux, Chimène à une extrémité, Don Fernand et sa cour à l’autre. Un chariot sur roues permettait les transferts de personnages. D’autres chemins de rouleaux perpendiculaires, plus réduits, correspondaient à Rodrigue, à Don Diègue, à Don Gormas et aux Maures, qui étaient en fait des formes en acier. Il s’agissait d’un système électromécanique programmé comportant éclairage et bande-son. Les programmes fondés sur une étude linguistique du texte de Corneille, organisaient le comportement des « objets-acteurs », et généraient « une version cybernétique de la représentation théâtrale ». Cette mise en scène tendait ainsi à utiliser les objets comme des éléments d’un vocabulaire agencés par une grammaire cohérente. Ces « marionnettes » évoluaient, montrant leur capacité de manier une pensée logique et d’intervenir sur leur destinée en fonction d’événements.
Les nouvelles technologies fondées sur la cybernétique et le développement de l’intelligence artificielle offrent aux créateurs contemporains un champ d’expérimentation aux possibilités très riches, mais qui peuvent aussi entretenir une certaine confusion. Il faut évoquer, pour la participation française aux prémices de cette aventure, Albert Ducrocq et son Renard cybernétique (1959) qui répondait à la tentation « de reproduire plusieurs mécanismes fondamentaux des actes cérébraux ». Une ambition que l’on retrouve dans certaines des recherches et créations les plus récentes en imagerie numérique et dans les nouvelles marionnettes interactives et virtuelles.
Bibliographie
- Artioli, Umberto, et Francesco Bartoli, eds. Il Mito dell’automa. Teatro e macchine animate dall’antichità al Novecento. Reggio Emilia: Artificio, 1990.[S]
- Bailly, Christian. Automata, The Golden Age, 1848-1914. London: Sothebys Publications, 1987.[S]
- Battisti, Eugenio. L’Antirinascimento. Milano: Feltrinelli, 1962.[S]
- Ceserani, Gian Paolo. Gli Automi. Storia e mito. Bari: Laterza, 1983.[S]
- Chapuis, Alfred. Les Automates dans les oeuvres d’imagination. Neuchâtel: Éditions du Griffon, 1947.[S]
- Chapuis, Alfred, and Edmond Droz. Les Automates: figures artificielles d’hommes et d’animaux. Histoire et technique. Neuchâtel: Éditions du Griffon, 1949.[S]
- Gendolla, Peter. Die lebende Maschine. Marburg an der Lahn: Hoppe, 1980.[S]
- Grimaud, Emmanuel. Dieux et robots. Les automates divins de Bombay. Coll. “L’âme du monde”. Montpellier: L’Archange Minotaure, 2008.
- “Images virtuelles”. Puck. No 9. Charleville-Mézières: Éditions de l’Institut international de la marionnette, 1996.
- Losano, Mario Giuseppe. Storie di automi. Dalla Grecia classica alla Belle Époque. Torino: Einaudi, 1990.[S]
- Metken, Günter. “Entre la marionnette et la machine: le théâtre mécanique de Harry Kramer”. Puck. No. 2 Charleville-Mézières: Éditions de l’Institut international de la marionnette, 1979, pp. 54-56.
- Möbius, Hanno, and Jörg Jochen Berns, eds. Die Mechanik in den Künsten. Studien zur ästhetische Bedeutung von Naturwissenschaft und Technologie. Marburg: Jonas Verlag, 1990.[S]
- Prasteau, Jean, and André Pieyre de Mandiargues. Les Automates. Paris: Grund, 1968.[S]
- Truitt, E. R. Medieval Robots. Middle Ages Series. Philadelphia: University of Pennsylvania Press/Penn Press, 2015, 296 pp. ISBN 978-0-8122-4697-1
- Video of Robert-Houdin Automata in Action http://blog.dugnorth.com/2008/02/video-of-robert-houdin-automata-in.html