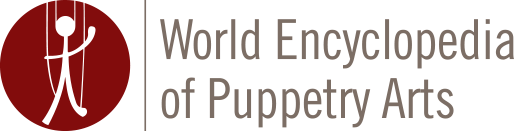Les relations entre marionnettes et cinéma sont multiples et s’articulent sur divers plans. Elles soulèvent en effet des questions d’ordre aussi bien théorique et thématique que symbolique et formel. Depuis les toutes premières formes de spectacle « pré-cinématographiques » qui ont conduit à l’invention du 7e art à la fin du XIXe siècle, ces deux univers présentent d’évidentes affinités : l’histoire des machines optiques, des premières visionneuses, des lanternes magiques, des mondi nuovi, et autres fantasmagories croise celle des marionnettes et des figures artificielles. Outre la même idée du « double », inhérente au mécanisme de création d’une image incorporelle (élément fondamental dans l’origine du cinéma), ces inventions nouvelles furent souvent présentées dans des situations similaires à celles des spectacles ambulants de marionnettistes et de montreurs d’ombres. En effet, les dispositifs mis au point au XVIIIe siècle dans les dioramas théâtraux ou dans l’eidophusikon de Philippe-Jacques de Loutherbourg (1740-1812) étaient des proches parents des petits théâtres de marionnettes. De même, les fantasmagories d’Étienne-Gaspard Robertson (1763-1837) n’ignoraient pas la tradition du théâtre d’ombres introduite en Occident par Séraphin et le montreur de lanterne magique faisait bouger ses figures en les accompagnant de paroles et de musique, tout comme le marionnettiste. De plus, dès ses origines, le cinéma voulut, à travers la mise en scène, dépasser les limites imposées par les lois physiques et les figures artificielles y trouvèrent une place importante. Il suffit de penser à Georges Méliès, qui sur un ton ludique et pré-surréaliste joua sur le thème de la désarticulation du corps à plusieurs reprises. Ainsi, dans Le Mélomane (1902), un directeur d’orchestre détache sa tête et la lance sur la portée formée des fils de deux poteaux télégraphiques pour créer ainsi une série de notes tandis que dans Un homme de têtes (1898), le jeu de têtes rappelle les spectacles des magiciens. C’est aussi dans le milieu des illusionnistes que Méliès recruta ses premiers acteurs, notamment les artistes du Théâtre Robert-Houdin. De son côté, dans le cinéma d’ « animation », qui désigne généralement le dessin animé, le procédé de la reprise cinématographique se rapproche du théâtre d’objets. Ainsi, en 1906-1907, aux États-Unis, Humorous Phases of a Funny Face et The Haunted Hotel de James Stuart Blackton, firent date par leurs nombreux trucs, parmi lesquels l’invention de l’animation cinématographique d’objets image par image : en prenant un photogramme à intervalles réguliers, Blackton réussit ainsi à imprimer à des objets durant quelques instants un mouvement impossible à saisir dans la réalité.
Les années vingt : l’effet marionnette
Dans les années vingt, en Europe, la même technique fut employée dans les dessins animés créés par Vladimir Maïakovski (1925), dans les films expérimentaux allemands comme ceux d’Oskar Fischinger et Walter Ruttman, dans les nombreux films que Lotte Reiniger réalisa jusque dans les années trente en s’inspirant de la tradition orientale des ombres et des expériences du Chat noir. Avec toutes ses références implicites à la figure perturbante (unheimlich) du double, à la présence surnaturelle ou démoniaque, avec sa dimension d’hallucination suggestive et déformante, l’ombre parcourt le cinéma expressionniste : L’Étudiant de Prague (1913) de Stellan Rye, Le Golem (1914) de Paul Wegener, Le Cabinet du docteur Caligari (1919) de Robert Wiene, Le Montreur d’ombres (1924) d’Arthur Robinson ou M le maudit (1931) de Fritz Lang. La poupée, la marionnette, l’automate, le Golem, l’homunculus, sont des thèmes récurrents de ce mouvement, comme l’illustre le robot de Metropolis (1926) de Lang, parent de ceux que l’on put voir pour la première fois en 1920 dans le drame RUR de Karel Čapek mais aussi Der Golem (1915) qui dans le sillage du roman de Gustav Meyrink envahirent les écrans pour exprimer la puissance de la machine se jetant à l’assaut de son propre créateur. On en retrouve l’écho par exemple dans Les Poupées du diable (1936) de Tod Browning où un scientifique crée une substance qui lui permet de miniaturiser les humains et de les pousser au crime. Il en est de même dans Die Puppe (La Poupée, 1919) d’Ernst Lubitch, un clin d’œil à l’Olympia de Hoffmann, qui joue sur l’équivoque et sur l’échange entre la poupée et la figure féminine, ou dans Le Cabinet des figures de cire (1924) de Paul Leni situé dans l’espace excentrique de la baraque de foire et où la scénographie et le jeu des acteurs – malhabile, haché et anti-naturaliste – sont proches de l’univers déformé des marionnettes. Jusqu’à l’œuvre expressionniste tardive de Max Ophüls, Lola Montès (1955) où la diva finit dans une baraque foraine, telle une figure de cire. On retrouve la figure artificielle dans toutes les cinématographies d’avant-gardes : chez les surréalistes notamment, le mannequin et le simulacre sont très présents comme en témoignent par exemple les films de Man Ray (Emak-Bakia, 1926, Le Mystère du château du Dé, 1929) ou de Germaine Dulac (La Coquille et le Clergyman, 1928).
Du point de vue formel, le principe du montage cinématographique rejoint celui en vigueur dans l’univers de la figure mécanique. Le « montage des attractions » formulé et théorisé en 1923 par Eisenstein (qui était alors sur le point de quitter le théâtre pour le cinéma) renvoyait aux exercices « biomécaniques » de son maître Meyerhold, en préconisant une mise en scène donnant au spectacle le rythme soutenu de la surprise créée par une structure antinarrative, procédant par « juxtapositions paratactiques », à l’instar du cirque, du music-hall et du cinéma. Toujours dans les années vingt, les « symphonies visuelles » abstraites de Viking Eggeling, Walter Ruttman, Hans Richter ou de Kurt Schwerdtfeger constituent des expérimentations sur la relation entre image et rythme. De même, les futuristes conçurent des compositions cinématographiques très proches de leurs « drames d’objets » qui ne furent, semble-t-il, jamais réalisées. L’esthétique de la machine était également présente dans L’Inhumaine de Marcel L’Herbier, non seulement dans la figure féminine mais aussi dans la mise en scène de cette « histoire féerique » dont les décors avaient été créés par Fernand Léger et dont la projection aux États-Unis en 1926 avait d’ailleurs été accompagnée de celle du Ballet mécanique. Ce film expérimental, du même artiste, sans scénario, créé en 1924 avec Man Ray et Dudley Murphy, était un montage d’éléments hétérogènes dont le thème était un « ballet », mais la danse y était conçue comme une mécanique du mouvement au sens abstrait, active dans la dynamique des corps et des machines. Il était introduit de manière emblématique par l’animation de la figure géométrisée de Charlot, créée à l’origine pour le « poème cinématographique » Die Chaplinade d’Yvan Goll. À cet égard, le jeu de Chaplin, acteur très apprécié dans le théâtre d’avant-garde, peut être rapproché de celui de la marionnette dans la mesure où il se distancie de l’identification psychologique. À l’antihéros des Temps modernes, on peut ajouter Buster Keaton (avec son corps curieusement articulé et son visage impassible) et des années plus tard l’acteur italien Totò notamment dans son interprétation de Pinocchio. Si celle-ci coïncidait avec le « caractère » du personnage de Collodi, l’acteur napolitain – qui avait pris les marionnettes comme modèle – n’interprétait pas un personnage mais jouait un rôle « fixe » à l’instar des masques de la commedia dell’arte faisant un avec les acteurs. On retrouva aussi l’univers des marionnettes et du spectacle itinérant dans Che cosa sono le nuvole ? (Qu’est-ce que sont les nuages ?) où à côté de Totò, apparaissent Ciccio et Ingrassia. Enfin, rappelons Sur un air de charleston (1927) de Jean Renoir, entièrement dédié à une ballerine aux mouvements de marionnette.
La marionnette au cinéma
Jusque dans les années cinquante, la marionnette n’est qu’indirectement présente au cinéma. Le mouvement des créatures réputées inertes était en effet créé par l’animation des images et non par un manipulateur. Il faut toutefois mentionner certaines exceptions comme Richard Teschner qui collabora avec l’UFA à partir de 1926 et travailla sur plusieurs films où apparaissaient ses marionnettes, comme Der geheimnisvolle Spiegel (Le Miroir mystérieux, 1927) de Carl Hoffmann, un travail au cours duquel lui vint probablement l’idée de son futur Figurenspiegel (Le Miroir aux figures). Les films de Jan Švankmajer constituent un cas singulier. Formé comme marionnettiste auprès de la Laterna Magika, cet artiste tchèque créa à partir des années soixante une série de films à l’atmosphère fantastique dans lesquels il introduisit des figures à l’aide des techniques les plus variées, comme dans Alice, où l’actrice humaine se meut aux côtés de marionnettes. Cette œuvre s’insère dans la culture praguoise en reprenant les thèmes de l’alchimie et de la cabale ainsi que des traditions de marionnettes (Punch et Judy par exemple) en provenance d’autres pays.
Dans les dernières décennies du XXe siècle, le rapport entre l’art de la marionnette et le cinéma change complètement. Le cinéma intègre la marionnette pour lui donner une fonction narrative, symbolique ou métaphorique. Parmi les exemples les plus remarquables, mentionnons les marionnettes de Bruce Schwartz dans La Double Vie de Véronique / Podwójne życie Weroniki (1991) de Krysztof Kieslowski qui servent d’un côté d’appui à la « trame en miroir » du film, de l’autre, renforcent symboliquement la figure du double qui le parcourt. Le rapport est encore plus évident dans Dolls (2003) de Takeshi Kitano : la tradition du bunraku japonais n’est pas seulement à la base du sujet tiré d’un célèbre texte de Chikamatsu Monzaemon (Double suicide à Sonezaki, XVIIIe siècle) mais le ningyô–joruri apparaît matériellement dans la scène d’ouverture, imprègne symboliquement le destin des protagonistes et détermine la forme du jeu des acteurs qui, dans leurs mouvements, lents et essentiels, semblent guidés par des « mains supérieures ». Le Danois Anders Rønow Klarlund dans Strings (2004) utilise quant à lui l’habileté technique d’une vingtaine de marionnettistes et une centaine de figures dans un film qui montre les hommes à la merci, entre ciel et terre, du destin qui les dirige. Il faut aussi mentionner les cas des films d’acteurs où la marionnette est employée comme métaphore comme dans De la vie des marionnettes (1980) d’Ingmar Bergman ou dans L’Année dernière à Marienbad (1961) d’Alain Resnais où les personnages se sentent comme mus dans l’espace par un « temps » qui leur est étranger.
Il existe enfin une très vaste production cinématographique, des classiques de Walt Disney à Qui veut la peau Roger Rabbit ? (1988) de Robert Zemeckis ou aux films de Tim Burton et de Steven Spielberg, qui mêlent techniques d’animation, fantoches de toutes sortes et acteurs. Parmi les « marionnettes » les plus souvent employées, figurent les créatures conçues grâce à la technique du remote control (contrôle à distance). Il s’agit ici de robots qui se différencient des marionnettes traditionnelles par l’absence de rapport physique direct entre la figure et le marionnettiste. Ces robots peuvent être de très grande taille ou de taille réduite selon les scènes et les décors où ils doivent intervenir : le film Jurassic Park (1993) de Steven Spielberg, pour ne citer qu’un exemple, utilisait toutes sortes de dinosaures manipulés par toutes sortes de techniques.
Enfin, la technologie numérique permet de créer des figures virtuelles qui si elles reprennent l’image du pantin, évoluent dans un espace et dans une dimension tout autres, comme l’illustrent Toy Story (1995) de John Lasseter ou Les Noces funèbres (2005) de Tim Burton. La marionnette électronique est évidemment une marionnette virtuelle qui semble apparemment réaliser l’idéal, né au début du XXe siècle, d’une figure aux possibilités illimitées, complètement libérée des lois de la physique, et dont la technique de manipulation n’a plus besoin d’être occultée. Le défi originel, celui de dépasser l’humain avec ses propres armes, s’est alors perdu.
(Voir aussi Animation.)
Bibliographie
- Bergman, Ingmar. “From the Life of the Marionettes (1980) [MultiSub] [Film] – (Ingmar Bergman)”. http://www.youtube.com/watch?v=jAGhiDgx1XA, Accessed 5 August 2013.
- Bertetto, Paulo. “Il cinema tra marionette, automi e altri turbamenti”. Il mito dell’automa. Teatro e macchine animate dall’antichità al Novecento. Eds. Umberto Artioli et Francesco Bartoli. Reggio Emilia: Artificio, 1990.
- Blackton, James Stuart. “Humorous Phases of Funny Faces”. http://www.youtube.com/watch?v=wGh6maN4l2I. Accessed 5 August 2013.
- Blackton, James Stuart. “The Haunted Hotel; or, The Strange Adventures of a Traveler” Preview. http://www.youtube.com/watch?v=aTE8gXCb_og. Accessed 5 August 2013.
- Browning, Todd, director. “Devil Doll, 1936”. http://www.youtube.com/watch?v=qfwajsx0MK4. Accessed 5 August 2013.
- Burton, Tim. “Tim Burton’s Corpse Bride – Trailer”. http://www.youtube.com/watch?v=_tpLNUI9rQU. Accessed 5 August 2013.
- Dulac, Germaine. “La Coquille et le Clergyman (1926, Germaine Dulac)”. http://www.youtube.com/watch?v=mYAo-dwZSrs. Accessed 5 August 2013.
- Fischinger, Oskar. “An Optical Poem (1938) – Classic Short Film”. http://www.youtube.com/watch?v=they7m6YePo. Accessed 5 August 2013.
- “Images virtuelles”. Puck. No. 9. Charleville-Mézières: Éditions de l’Institut international de la marionnette, 1996.
- Kitano, Takeshi. “Dolls Intro (2002 Takeshi Kitano)”. http://www.youtube.com/watch?v=hO9zWak9uwg. Accessed 5 August 2013.
- Klarlund, Anders Rønow. “Strings Movie (English) Part 1/9”. http://www.youtube.com/watch?v=Hgyh8k6Dmwg&list=PLEAEAEED9877AD319. Accessed 5 August 2013.
- “La capture gestuelle, marionnettes de synthèse”. Pédagogie et formation. Paris: Éditions Théâtrales/THEMAA, 2004.
- Lang, Fritz. “Fritz Lang: Metropolis (1927)”. http://www.youtube.com/watch?v=AiOzNd9kshI. Accessed 5 August 2013.
- Lang, Fritz. “M (1931) Fritz Lang VINTAGE FILM”. http://www.youtube.com/watch?v=WCEzfjERfvo, Accessed 5 August 2013.
- Lasseter, John. “Toy Story – Official Trailer #1 [1995]”. http://www.youtube.com/watch?v=KYz2wyBy3kc. Accessed 5 August 2013.
- Léger, Fernand. “Le Ballet Mécanique (1924, Fernand Leger)”. http://www.youtube.com/watch?v=H_bboH9p1Ys. Accessed 5 August 2013.
- Legrand, Gérard. “Les marionnettes dans le cinéma”. Les Marionnettes. Ed. Paul Fournel. Paris: Bordas, 1982; repr. 1985 and 1995.
- L’Herbier, Marcel. “1924. ‘L’Inhumaine’’. http://www.youtube.com/watch?v=-vJA5QEJE5M. Accessed 5 August 2013.
- Leni, Paul. “Waxworks. 1924”. http://www.youtube.com/watch?v=iNTuHjq64RA. Accessed 5 August 2013.
- Lubitch, Ernst. “Die Puppe (1919)”. http://www.youtube.com/watch?v=hmAaO5i7DnE. Accessed 5 August 2013.
- Méliès, Georges. “The Music Lover (Le Melomane) 1902/1903”. http://www.youtube.com/watch?v=VmXIMNhQL3g. Accessed 5 August 2013.
- Méliès, Georges. “Un Homme de têtes”. http://www.youtube.com/watch?v=646GBVOTgzs. Accessed 5 August 2013.
- Ophuls, Max. “Lola Montes 1955”. http://www.youtube.com/watch?v=KuLb53N-XCY. Accessed 5 August 2013.
- Pasolini, Rier Paolo. “Toto’ – Che cosa sono le nuvole?”. http://www.youtube.com/watch?v=JXZfO3bJwuc. Accessed 5 August 2013.
- Poulter, Robert. “Robert Poulter’s New Model: The Eidophusikon”. http://www.newmodeltheatre.co.uk/eidophusikon.html. Accessed 5 August 2013.
- Puck. No. 15: Les marionnettes au cinema. Montpellier: Éditions de l’Institut international de la marionnette/L’Entretemps, 2008.
- Ray, Man (Emmanuel Radnitzky). “Emak-Bakia (1926, Man Ray)”. http://www.youtube.com/watch?v=L1y-OA6yf5s. Accessed 5 August 2013.
- Ray, Man. “Les Mystères du Château de Dé (1929, Man Ray)”. http://www.youtube.com/watch?v=OpPC87i7nv0. Accessed 5 August 2013.
- Reiniger, Lotte. “Lotte Reiniger – The Adventures of Prince Achmed”. http://www.youtube.com/watch?v=25SP4ftxklg. Accessed 5 August 2013.
- Renoir, Jean. “Charleston Jean Renoir Katherine Hessling Tuareg Music”. http://www.youtube.com/watch?v=qg-r6L9CJTI. Accessed 5 August 2013.
- Robinson, Arthur. “Warning Shadows- Schatten-Eine nächtliche Halluzination”. http://www.youtube.com/watch?v=z3hkgr-8V9o. Accessed 5 August 2013.
- Ruttmann, Walter. “Walter Ruttmann – Lichtspiel Opus I (1921)”. http://www.youtube.com/watch?v=k9vSRPN4jDk. Accesed 5 August 2013.
- Rye, Stellen. “The Student of Prague (1913)”. http://www.youtube.com/watch?v=NWycNxqotmQ. Accessed 5 August 2013.
- Schifano, Laurence. La Vie filmique des marionettes. Paris: Presses universitaires de Paris X, 2008.[S]
- Schwartz, Bruce. “La double vie de Veronique”. http://www.youtube.com/watch?v=TEVlDb43v-4. Accessed 5 August 2013.
- Švankmajer, Jan. “Jan Švankmajer – A Game with Stones 1965”. http://www.youtube.com/watch?v=vphD1i5pN80. Accessed 5 August 2013.
- Švankmajer, Jan. “Jan Svankmajer (1968) – Picnic With Weissmann”. http://www.youtube.com/watch?v=TrgOnL1Yyvk. Accessed 5 August 2013.
- Švankmajer, Jan. “Neco z Alenky (Alice) 1988 – Jan Svankmajer”. http://www.youtube.com/watch?v=mKoDLFghZo0. Accessed 5 August 2013.
- Spielberg, Steven. “Jurassic Park First Trailer”. http://www.youtube.com/watch?v=Bim7RtKXv90. Accessed 5 August 2013.
- “Toto Pinochio”. http://www.youtube.com/watch?v=pUBU1SJTLZg. Accessed 5 August 2013.
- Teschner, Richard. “Christmas”. http://www.youtube.com/watch?v=JY38P-6TYQM. Accessed 5 August 2013.
- Wegener, Paul, director. “1920 The Golem (Paul Wegener, Albert Steinruck, Lyda Salmonova)”. http://www.youtube.com/watch?v=8EtX4D_fZwA. Accessed 5 August 2013.
- Wiene, Robert. “The Cabinet of Dr. Caligari (1920) [Full Classic Horror Movie HQ]”. http://www.youtube.com/watch?v=AP3WDQXkJq4. Accessed 5 August 2013.
- Wilson, Steven S. Puppets and People. Dimensional Animation Combined with Live Action in the Cinema. New York: A. S. Barnes and Co., 1980.
- Zemeckis, Robert. “Movie Trailer – 1988 – Who Framed Roger Rabbit?” http://www.youtube.com/watch?v=OFCIaMyMORg. Accessed 5 August 2013.