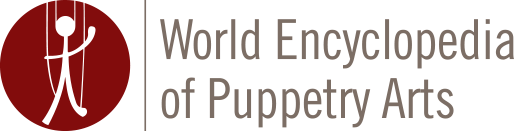À l’incarnation du personnage théâtral par un acteur, les marionnettes ajoutent une autre fiction : celle de faire vivre un objet inanimé. Mal comprise, cette spécificité a conduit certains théoriciens du théâtre à exclure la marionnette du champ de l’art dramatique, pour ne voir en elle qu’une forme de spectacle comparable au cirque ou à la danse. Une telle réduction ne résiste pas à l’examen : tout comme la scène, le castelet offre aux regards des spectateurs l’imitation d’une action et la similitude de ces deux arts de la représentation, théâtre d’acteurs et théâtre de marionnettes, est encore renforcée par les transferts et les échanges qu’ils ont toujours entretenus.
L’histoire montre que le théâtre de marionnettes s’est développé en investissant l’espace où le théâtre d’acteurs ne pouvait pénétrer – pour des raisons pragmatiques, religieuses, politiques et économiques. Spectacle des rues et des villages, des demeures privées et des foires, la marionnette a longtemps eu pour fonction de représenter, devant un autre public ou dans un autre cadre, les mêmes histoires que le comédien, au point de se substituer facilement à lui. Ainsi, en Chine, elle a permis la diffusion, dans les campagnes, des opéras joués dans les grandes villes ; en Inde et dans le Sud-Est asiatique, elle représente les grandes épopées hindouistes du Râmâyana et du Mahâbhârata qui constituent aussi le répertoire privilégié des autres formes de spectacle. De même, en Sicile, l’opera dei pupi et l’art de l’acteur-conteur (Cantastorie ou cuntu) développent les mêmes récits mettant en scène les compagnons paladins de Charlemagne (voir Conteurs). Cette proximité des deux moyens d’expression a encore permis, par exemple, au dramaturge japonais Chikamatsu Monzaemon (1653-1724) de passer sans difficulté du kabuki à ce qui ne s’appelait pas encore bunraku, ou bien à certains auteurs français du XVIIIe siècle (Le Sage, d’Orneval), d’écrire alternativement pour l’une ou l’autre scène suivant les marges de liberté dont ils pouvaient bénéficier. L’appellation de « pièce pour marionnette », enfin, a parfois été utilisée par les écrivains pour mettre en garde d’éventuels interprètes contre une mise en scène trop réaliste ou trop psychologique de leurs œuvres, sans que celles-ci soient pour autant véritablement destinées au castelet. C’est le cas des premières pièces de Maurice Maeterlinck (La Princesse Maleine 1889 ; Alladine et Palomide, Intérieur, La Mort de Tintagiles : « trois petits drames pour marionnettes » 1894), des trois farces de Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) réunies sous le titre de Tablado de marionetas para educación de príncipes (Tréteau de marionnettes, 1909-1920), ainsi que de plusieurs pièces de Michel de Ghelderode (1898-1962), Le Siège d’Ostende (1933), D’un diable qui prêcha merveilles (1942).
Ce n’est donc qu’à l’intérieur de certaines cultures et à certains moments de leur histoire que le théâtre d’acteurs et le théâtre de marionnettes se sont clairement différenciés, en développant chacun un répertoire spécifique. Bien plus souvent, le déplacement et la porosité des frontières qui les séparaient ont conduit les deux arts à se définir uniquement en fonction de clivages économiques et sociaux. Encore certains types d’échange ont-ils pu, même dans ce cas, subsister, le langage populaire de la marionnette devenant alors comme l’envers parodique et irrévérencieux de celui du comédien.
La « marionnettisation » de l’acteur en Europe
Au XIXe siècle, tandis qu’une dramaturgie autonome était accordée à la marionnette, en particulier grâce à la faveur dont jouirent différents types nationaux et régionaux (Punch, Kasperl, Petrouchka, Guignol, Tchantchès, Pulcinella, Sandrone … ), les contraintes propres à ce mode d’expression commencèrent à être envisagées dans le monde artistique et intellectuel comme autant de potentialités originales, certains écrivains allant jusqu’à affirmer sa supériorité sur le théâtre d’acteurs. Bonaventura, Heinrich von Kleist, Charles Nodier, Anatole France, Alfred Jarry ou Maurice Maeterlinck renversèrent ainsi les termes habituels de la comparaison entre l’interprète vivant et son double inanimé, pour faire du second le modèle du premier. Car si la marionnette s’emploie souvent, par tradition, à imiter l’acteur, le mouvement inverse peut aussi se produire, soit à titre d’hypothèse théorique, soit comme exploration de nouvelles possibilités spectaculaires. Ainsi put-on voir chez les symbolistes et les artistes du Modern Style, puis chez Edward Gordon Craig, Vsevolod Meyerhold et dans les groupes d’avant-garde, la scène des marionnettes devenir le terrain d’anticipation, voire d’expérimentations des révolutions théâtrales de l’avenir. L’ancienne comparaison de l’acteur et de la marionnette, qui ne débouchait généralement que sur des considérations ironiques ou économiques (les marionnettes ne réclament pas de gages, elles ne s’enivrent pas, elles ne souffrent d’aucune indisposition qui les empêcherait de jouer), devient ainsi le lieu d’une nouvelle définition de l’incarnation théâtrale, indissociable de l’émergence de la mise en scène. André Antoine, par exemple, déclarait en 1893, dans une lettre à Charles Le Bargy, jeune sociétaire de la Comédie-Française, que les comédiens n’étaient autres que des « marionnettes plus ou moins perfectionnées, suivant leur talent, que l’auteur habille et agite à sa fantaisie ». Mais c’est surtout L’Acteur et la Surmarionnette d’Edward Gordon Craig (1907) qui conféra à l’interprète artificiel, matériau tout à la fois plus malléable et plus fiable que l’être vivant, le statut de modèle d’un art régénéré.
L’acteur marionnette : les premières réalisations scéniques
Les interférences entre acteurs et marionnettes apparurent dès la seconde moitié du XVIIIe siècle lorsque des enfants furent utilisés en guise de « marionnettes » vivantes dans de petits spectacles où ils apparaissaient parfois conduits par un fil d’archal (dans ceux de la troupe Audinot en particulier), tandis que des comédiens dissimulés en coulisses récitaient leurs rôles. C’est aussi à cette époque que furent expérimentées les « ombres espagnoles », des représentations de théâtre d’ombres où des acteurs prenaient la place des figurines habituelles. Dans les premières années du XIXe siècle, des comédiens comme Élie ou Mazurier se spécialisèrent dans des numéros de « Polichinelle vivant » dans lesquels ils s’attachaient à imiter le costume et la gestuelle du pantin. Ces premières expériences, qui ne mettaient l’accent que sur l’étrangeté du corps « marionnettisé », restèrent sans prolongement immédiat mais elles resurgirent à la fin du siècle sur les planches du music-hall ou encore dans la mise en scène d’Ubu roi à l’occasion de laquelle Alfred Jarry déclara qu’il n’avait pas conçu sa pièce « pour marionnettes mais pour des acteurs jouant en marionnettes, ce qui n’est pas la même chose ».
C’est au début du XXe siècle, principalement sous l’impulsion des avant-gardes historiques, que la « marionnettisation » de l’acteur ou du danseur connut une nouvelle faveur, jusqu’à apparaître comme l’un des modes d’exploration privilégiés de nouveaux langages scéniques. Cette transformation de l’interprète en effigie pouvait signaler l’irruption de la modernité en montrant une humanité « mécanomorphe » comme dans le futurisme italien. Elle pouvait aussi servir de modèle pour redéfinir la convention théâtrale (Pierre Albert-Birot, Vsevolod Meyerhold) ou avoir pour objectif d’unifier le corps et la scénographie en étendant le masque à l’ensemble de la figure humaine comme dans le futurisme, le constructivisme et le Bauhaus. En déplaçant les équilibres corporels, en occultant l’expressivité du visage et en bloquant les articulations par la construction même du costume et du masque on modelait ou on modélisait le vivant sur l’artificiel. Les manifestations les plus spectaculaires de cette modélisation furent les costumes de Pablo Picasso pour les Managers de Parade par les Ballets russes de Serge de Diaghilev (1917), de Kasimir Malevitch pour l’opéra Victoire sur le soleil (1913) ou d’Oskar Schlemmer pour son Ballet triadique (1922). La diffusion des écrits de Craig, la relecture de Kleist (Sur le théâtre de marionnettes) et, dans une moindre mesure, du Paradoxe sur le comédien de Diderot, alimentèrent tout au long du XXe siècle, l’interrogation souvent fascinée sur les relations d’analogie qu’entretiennent l’acteur et la marionnette. Ainsi Tadeusz Kantor, dans son manifeste Le Théâtre de la mort (1975), se réfère-t-il explicitement à L’Acteur et la Surmarionnette pour développer l’image d’un art dans lequel le mannequin, prenant en charge la figuration de la mort, servirait de modèle à l’acteur vivant.
Sur un autre plan, l’héritage plastique des avant-gardes, qui se diffusa largement dans la danse contemporaine (Philippe Découflé, Maguy Marin, Josef Nadj) mais aussi dans le cirque ou le théâtre de rue, donna naissance, à partir des années quatre-vingt, à un répertoire de figures où les images du pantin et de la marionnette étaient fréquemment convoquées. Enfin, l’interprète marionnette réapparaît aujourd’hui avec les technologies numériques et virtuelles pour porter à la scène le mythe d’une nouvelle corporalité, entre vie naturelle et animation artificielle. Cette dimension est explorée par exemple par le danseur australien Stelarc, dans des performances au cours desquelles, son corps, relié par des électrodes à un modèle virtuel diffusé sur Internet, se trouve indirectement manipulé par les impulsions que lui transmettent les utilisateurs du réseau. (voir Marionnette virtuelle). Ainsi l’homme-marionnette, longtemps représentation allégorique de la condition humaine sous l’empire des transcendances religieuses, puis du pouvoir politique et de l’ordre social, symbolise-t-il aujourd’hui l’ambivalence de notre rapport à la technique.
La marionnette sur la scène : aspects dramaturgiques
Outre son rôle de modèle pour le travail de l’interprète, la marionnette s’est trouvée intégrée sur le plateau, au côté des comédiens de chair et de sang. Une telle situation implique des transformations au moins aussi profondes puisqu’elle rompt immédiatement l’homogénéité de la représentation en creusant un écart entre différents modes d’incarnation. Si l’on excepte quelques œuvres isolées telles que La Foire de Saint-Barthélemy de Ben Jonson (1614), où la présence scénique d’un castelet remplissait la double fonction d’offrir une reconstitution de la foire londonienne et de ridiculiser, à l’issue d’un dialogue burlesque, les dévots qui condamnaient le théâtre, il faut attendre les dernières années du XIXe siècle et le début du XXe siècle pour rencontrer des dramaturges qui prennent ainsi le risque de réunir, dans un même espace, l’acteur vivant et la marionnette. Dans César-Antechrist, Alfred Jarry imagina l’apparition sur scène du Christ « par contraire, miroir ou reflet », mais pour Ubu roi, il mêla (ou souhaita mêler) aux acteurs des ombres projetées, des mannequins et divers postiches, accentuant par ce biais, l’étrangeté monstrueuse du personnage central.
La plupart du temps, en effet, le rapprochement de la figure humaine et de son double inanimé s’intégrait au début du XXe siècle dans une problématique théâtrale faisant une large part au grotesque. C’est le cas par exemple des pièces d’Arthur Schnitzler (À la grande saucisse, 1905), d’Alexandre Blok (La Petite Baraque de foire, 1906) et surtout d’Oskar Kokoschka (Sphinx et homme de paille, 1907) ou de Massimo Bontempelli qui, dans La Haie du nord-ouest (1919), faisait intervenir comédiens, marionnettes à fils et poupées à gaine sur trois niveaux de l’action dramatique. Certains allèrent jusqu’à transformer progressivement l’image de l’homme en celle du robot comme Filippo Tommaso Marinetti dans Les Poupées électriques de (1909) ou plus tard, Karel Čapek, dans R.U.R (1920). Dans ces derniers exemples cependant, comme dans Monsieur de Pygmalion du dramaturge espagnol Jacinto Grau (1921) et dans la plupart des œuvres du répertoire du « théâtre grotesque » italien des années vingt (Luigi Antonelli, Luigi Chiarelli, Pier Maria Rosso di Sansecondo), marionnettes, robots et mannequins devaient être incarnés par des acteurs vivants, ce qui diminuait considérablement leur potentiel d’étrangeté. De même, dans l’art du ballet, le motif de la marionnette animée, plusieurs fois exploré au cours du XXe siècle, ne donna généralement lieu qu’à l’imitation par un danseur, de façon étrange ou burlesque, des mouvements du pantin : ainsi de Petrouchka (1911) d’Igor Stravinsky, ou du Prince de bois (1917) de Béla Bartók.
En revanche, chez les écrivains les plus représentatifs des avant-gardes historiques, l’intrusion de marionnettes véritables au milieu de personnages humains conduisit à mettre radicalement à l’épreuve les modes de l’incarnation théâtrale. Physiquement présente dans sa matérialité et dans sa gestuelle particulière, et non pas simplement imitée par un acteur vivant, la marionnette frappait alors l’action dramatique d’irréalité, créant un espace d’incertitude entre différents niveaux d’existence. C’est par exemple le cas dans les « synthèses futuristes » comme Le Tremblement de terre (1915) de Francesco Balilla Pratella, d’Ombres, Pantin, Hommes (1920) de Luciano Folgore, dans l’esquisse théâtrale L’Horloge à court-circuit (1922) intégrée par Robert Desnos dans le récit Pénalités de l’Enfer ou Nouvelles-Hébrides (1922) ou dans Arc-en-ciel de Georges Ribemont-Dessaignes. Dans les drames comiques de Pierre Albert-Birot (Larcantala, 1918 ; La Dame énamourée, 1921), enfin, le double jeu des marionnettes et des comédiens sert le dédoublement des personnages et la mise en scène des figures de l’auteur. Par ailleurs, d’un point de vue dramaturgique, la présence de marionnettes, lorsqu’elle se manifeste à l’intérieur d’un castelet transposé sur le plateau de la scène, constitue une variante du procédé baroque du « théâtre dans le théâtre », permettant à l’auteur d’y mettre en scène les relations de la fiction théâtrale et de la réalité. Entre les deux guerres ce procédé fut particulièrement exploité par Michel de Ghelderode (Le Sommeil de la raison, 1930 ; Le soleil se couche, 1933), Luigi Pirandello (Les Géants de la montagne, 1931-1937) ainsi que, dans une moindre mesure, dans Le Retable de Maître Pierre (1923), l’opéra que composa Manuel de Falla à partir du célèbre épisode de Don Quichotte.
Le renouveau de la dramaturgie dans les années soixante eut souvent recours aux images du masque, du mannequin (Eugène Ionesco), voire du corps aliéné ou chosifié (Samuel Beckett, Arthur Adamov) mais ne s’aventura pas au-delà, dans la mise en perspective de l’homme et de ses doubles. En revanche, chez les auteurs de la fin du XXe siècle, l’intégration de la marionnette dans des pièces destinées au théâtre d’acteurs resurgit avec la redéfinition de la notion de personnage et des frontières de l’humain : corps-objet, figures intermédiaires entre les choses et les êtres, entre le silence et la parole, comme dans l’adaptation mise en scène par Valère Novarina de sa pièce-fleuve La Chair de l’homme (1995) ou plus systématiquement chez Didier-Georges Gabily (Chimères et autres bestioles, 1994 ; Gibiers du temps, 1995).
La marionnette sur la scène : aspects scéniques
Même arrachée à son cadre traditionnel et transportée sur la scène du théâtre d’acteurs, la marionnette crée d’emblée un espace spécifique qui rend impossible toute figuration réaliste : soit en conférant au plateau théâtral une dimension allégorique ou plus généralement métaphysique, soit en le projetant dans la sphère ambiguë des simulacres, soit encore en faisant de la scène le lieu d’une incarnation dégradée, tournée vers le rire et la vengeance publique. Dans la première de ces options, s’inscrit l’ensemble des rites et des cérémonies qui, depuis les Mitouries de Dieppe jusqu’aux danses théâtralisées des Indiens hopi et aux marionnettes traditionnelles du Mali, mêlent acteurs vivants et interprètes artificiels dans la célébration de cultes spectaculaires. Aussi n’est-il pas surprenant que certains metteurs en scène, désireux de recharger la représentation théâtrale d’une efficacité religieuse, aient pu être tentés d’associer acteurs et marionnettes pour inventer de nouveaux mystères : tel est en particulier le cas d’Edward Gordon Craig qui vers 1906, esquissa le projet d’une Duse Play où la tragédienne Eleonora Duse aurait été seule en scène, « tout le reste se déplaçant autour d’elle comme un rêve, masques et surmarionnettes ». De la même façon, Antonin Artaud, dans une conférence prononcée en 1931, envisagea de recourir ponctuellement à « l’apparition d’un Être inventé, fait de bois et d’étoffe, ne répondant à rien et cependant inquiétant par nature, capable de réintroduire sur la scène un petit souffle de cette grande peur métaphysique qui est à la base de tout le théâtre ancien ».
Mais c’est bien plus souvent entre l’exploration de la puissance poétique des effigies et leur usage critique, comme métaphores d’une humanité vidée de toute substance vivante, que l’association de ces deux modes de l’incarnation théâtrale fut expérimentée au cours du XXe siècle. Silhouettes acheminées sur un tapis roulant chez Erwin Piscator (Les Aventures du brave soldat Chveik, 1928), grandes figures cartonnées chez Art et Action (Les Noces, 1923), figures articulées intégrées dans les spectacles de l’atelier théâtral du Bauhaus (Oskar Schlemmer, Cabinet figural, 1922), « fusion de personnages automatiques et vivants » imaginée par Fortunato Depero dans son Manifeste du théâtre magique (1927), les hypothèses explorées sur les scènes expérimentales des années 1920 ont trouvé chez nombre de metteurs en scène des années soixante et soixante-dix, une nouvelle vigueur. Dans un sens politique tout d’abord : popularisé par le Bread and Puppet Theater (Le Cri du peuple pour la viande, 1969), l’usage conjoint d’acteurs, de masques et de grandes marottes – que l’on retrouve par exemple chez Armand Gatti (La Passion du général Franco, 1967), Dario Fo (Grande pantomima con pupazzi piccoli e medi Grande pantomime avec pupazzi petits et moyens, 1968) ou dans les spectacles du Théâtre de recherche et de rue de Mehmet Ulusoy (1968-1971) – est l’un des moyens artistiques privilégiés par les hommes de théâtre et les compagnies qui s’inscrivent dans une démarche militante pour investir, hors du cadre de scène, l’espace public.
Formes essentiellement populaires, liées aux cortèges et aux carnavals, les marionnettes géantes et les « grosses têtes », utilisées par Joan Baixas et Joan Miró pour Mori el Merma (1978), irriguèrent aussi le théâtre d’acteurs dans les grands spectacles des années soixante et soixante-dix : on les rencontra en particulier chez Peter Brook (US, 1966), dans le théâtre Za Branou d’Otomar Krejca (Lorenzaccio, 1969) ou bien chez Ariane Mnouchkine et son théâtre du Soleil (1789, 1970). Elles continuent depuis d’apparaître dans des compagnies qui, comme le Ki Yi Mbock Théâtre en Côte d’Ivoire, s’emploient à inventer de nouveaux langages spectaculaires à partir d’éléments provenant de cultures traditionnelles.
L’effacement des frontières
L’évolution du théâtre de marionnettes, sortant lui aussi des limites du castelet pour investir la totalité du plateau, ne pouvait conduire qu’à un certain effacement des frontières avec le théâtre d’acteurs. Il en est ainsi lorsqu’il privilégie les modes de manipulation à vue qui intègrent la figure du marionnettiste dans la dramaturgie et la scénographie du spectacle (parfois jusqu’à faire jouer et à habiller le montreur) ou lorsqu’il combine librement, à l’intérieur d’une même représentation, différentes techniques de manipulation. Nombre de spectacles créés ou présentés dans les années quatre-vingt-dix dans le cadre institutionnel du théâtre de marionnettes (écoles, festivals, programmations spécifiques) semblaient ne plus avoir recours qu’incidemment, voire indirectement, à cet instrument. Inversement, si l’usage de la figure animée dans le théâtre d’acteurs restait limité à quelques brèves séquences chez Ariane Mnouchkine (La Ville parjure, 1994) ou Robert Lepage (Les Sept Branches de la rivière Ota, 1994-1996), il n’en allait déjà plus de même dans des mises en scènes telles que celles d’Antoine Vitez (La Ballade de Mister Punch, 1976), de Peter Brook (La Conférence des oiseaux, 1979), de Carmelo Bene (Pinocchio, 1981), de Tadeusz Kantor (La Machine de l’amour et de la mort, 1987) ou de Jacques Nichet (L’Épouse injustement soupçonnée, 1995), à l’intérieur desquelles la marionnette jouait un rôle de premier plan.
Ce sont donc fondamentalement le positionnement institutionnel de l’artiste ou de la compagnie, le circuit de diffusion dans lequel ils s’insèrent et le public auquel ils s’adressent (en particulier dans la relation à l’enfance) qui peuvent encore dessiner, aujourd’hui, une ligne de partage entre le théâtre d’acteurs et le théâtre de marionnettes. Le cas de la compagnie Philippe Genty, dont les spectacles sont indifféremment présentés dans des programmations de danse ou de marionnettes, est exemplaire à ce titre, puisqu’il démontre que le cloisonnement des procédures de la reconnaissance publique peut être au moins partiellement levé. Quelle que soit son inscription territoriale (théâtre d’acteurs, marionnette, danse, mime, cirque, etc.), le spectacle vivant aujourd’hui, est contraint de redéfinir périodiquement les instruments et les langages de la représentation : en ce sens, choisir la marionnette à gaine ou à fils, ou les ombres, choisir le jeu caché ou à vue, n’est plus seulement une façon de marquer son identité (traditions familiales ou régionales, formations spécialisées, stratégies d’implantation locales, etc.). Il s’agit de se redéfinir en fonction de chaque nouvelle création.
Bibliographie
- Craig, Edward Gordon. De l’Art du théâtre. Paris : Librairie Théâtrale, Lieutier, 1950.
- Plassard, Didier. L’Acteur en effigie. Lausanne : L’Âge d’Homme/Institut international de la marionnette, 1992.
- Plassard, Didier. Les Mains de lumière. Charleville-Mézières : Institut international de la marionnette, 1996.
- Romeas, Nicolas. « Ce que la marionnette dit à l’acteur ». Les Fondamentaux de la manipulation. Paris : Éditions Théâtrales/THEMAA, 2003.