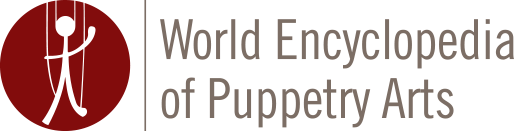À strictement parler, il s’agit du ningyô-jôruri, c’est-à-dire d’un livret de type jôruri joué par des poupées (ningyô), mais au début du XXe siècle, le nom de bunraku s’imposa peu à peu au point d’être aujourd’hui, au Japon et dans le monde, la désignation habituelle. Ce nom reprenait celui du Bunraku-za – seule salle alors spécialisée dans cet art. Genre dramatique japonais, constitué de trois éléments : le texte, joué-narré-chanté par un récitant appelé tayû, la musique jouée par un instrument « à trois cordes », le shamisen, et de grandes marionnettes manipulées à vue qui miment les actions des personnages.
Le jôruri
La présentation orale de textes s’inscrit au Japon dans une longue tradition de conteurs itinérants diffusant légendes et récits édifiants. Déjà attestée au VIIIe siècle, elle connut un essor particulier à partir du XIIIe siècle avec les biwa-bôshi (moines au biwa) – des conteurs, en général aveugles, en principe placés sous la protection d’un centre religieux – qui, s’accompagnant au biwa (luth chinois à quatre cordes), diffusaient des récits tirés des épopées du cycle des Heike retraçant les affrontements entre les clans Taira et Minamoto de la seconde moitié du XIIe siècle. Peu à peu, le répertoire s’élargit et des récits explorant davantage les veines fantastiques ou romantiques apparurent, parmi lesquels précisément le Jôruri-jûnidan zôshi (L’histoire de Jôruri en douze épisodes). Ce récit narre les amours de Minamoto no Yoshitsune, le héros emblématique de la chevalerie japonaise, et de la belle Jôruri, en laquelle va s’incarner, le temps de sauver le héros mourant, Yakushi Nyôrai, le bouddha guérisseur. Le conte remporte un tel succès dans la seconde partie du XVIe siècle qu’il finit par désigner génériquement tous les récits s’inscrivant dans cette veine.
Shamisen et tayû
Au début de la seconde moitié du XVIe siècle, le jabisen, une sorte de luth populaire à Okinawa, est introduit dans la région d’Ôsaka. C’est un instrument à trois cordes de soie tressée, muni d’un long manche de bois et d’une caisse de résonance assez petite, presque carrée, tendue d’une peau de serpent (jabi). Il s’agit en fait d’une variante locale du sanxian, un instrument chinois influencé par la musique d’Asie centrale, qui apparut en Chine sous le règne des Yuan, au XIIIe siècle. Plus léger et plus maniable que le biwa, le jabisen, outre son appel exotique, offre davantage de possibilités musicales. Il fut vite adopté par les musiciens japonais qui lui apportèrent quelques modifications, notamment en remplaçant la peau de serpent (trop fragile et difficile à se procurer au Japon même) par une peau de chat, ou de chien, qui vibrait mieux et résistait aux techniques de percussion auxquelles recourait également le musicien lorsqu’il frappait la peau de son plectre d’ivoire. Appelé désormais shamisen, le nouvel instrument rencontra un immense succès et se retrouva partout, surtout au kabuki et dans le monde des quartiers de plaisir où il accompagnait danses et chansons. Il en existe trois types, dont le plus grand et plus lourd, le futozao shamisen, est réservé au bunraku.
Ce seraient des conteurs de Kyôto, Sawazumi Kengyô et Takino Kôtô, appartenant, comme l’indiquent les titres de kengyô ou de kôtô, à la guilde des conteurs aveugles, qui auraient les premiers remplacé le biwa par le nouvel instrument. Leurs disciples poursuivirent dans cette voie et finirent par travailler avec des marionnettistes d’Awaji (voir Awaji Ningyô-Za) qui apportaient une dimension plastique, un attrait visuel supplémentaire, à leur récitatif. Le bunraku se développa donc à partir de la réunion des conteurs et des marionnettistes, qui travaillaient auparavant chacun de leur côté, et de la participation de musiciens spécialisés. Cette répartition des tâches représente un tournant majeur dans l’évolution du théâtre de poupées, car auparavant les conteurs s’accompagnaient eux-mêmes, se contentant de ponctuer leur déclamation de quelques accords de biwa, ou de rythmer leur chant en frappant les nervures de leur éventail. Désormais, les artistes allaient se spécialiser et polir toujours davantage leur art.
Le spectacle
De nos jours, le spectacle consiste le plus souvent en plusieurs parties, tableaux choisis dans diverses pièces ou un court sewamono (tragédie bourgeoise) suivi d’un acte choisi d’un jidaimono (drame historique), parfois, plus rarement, d’une grande pièce historique en version intégrale. Les pièces elles-mêmes sont de longs récits entrecoupés de dialogues que le tayû interprète seul, assurant tous les personnages, quels que soient leur âge, leur sexe et leur condition sociale. Il passe d’un registre à l’autre, se faisant tour à tour solennel, sarcastique, maniéré, ému, pathétique, minaudier ou querelleur. Il complète sa virtuosité verbale par la maîtrise de toute une gamme de rires et de pleurs, et souligne les situations par des jeux de physionomie hautement expressifs. On distingue trois modes de production vocale fondamentaux : le kotoba, proche de la langue parlée, est utilisé pour les dialogues, normalement sans appui musical ; le jiai, écrit dans un style soutenu, poétique, relate les événements, décrit les états d’âme des personnages et commente le développement de l’intrigue, il est récité sur un ton vigoureux, bien rythmé et soutenu par le shamisen ; enfin, le fushi, est la seule partie véritablement chantée, richement mélodique.
Le musicien orne musicalement l’interprétation du tayû ; il crée l’atmosphère, ponctue la narration et jette des passerelles musicales entre les moments de silence narratif. Il introduit aussi parfois des ballades ou d’autres mélodies populaires. Apparemment effacé, il n’entre jamais en compétition avec la voix du tayû, mais il joue cependant un rôle majeur et d’une certaine manière dirige l’ensemble de l’interprétation et en dicte le rythme. Il faut d’ailleurs une très longue expérience pour former une paire tayû-shamisen complètement équilibrée et en parfaite harmonie. Aussi, une fois constituées, les grandes paires jouent-elles ensemble pendant de longues années et ne changent guère de partenaire.
Le récitant tayû et le musicien de shamisen, en tenue de cérémonie (kamishimo) de l’époque d’Edo, prennent place sur une estrade – le yuka – installée en dehors du plateau même, côté cour. Assis sur ses talons, le tayû a devant lui, posé sur un lutrin, le livret dont il tourne respectueusement les pages (bien qu’il en connaisse le contenu par cœur) ; sinon, les mains posées sur les genoux, il joue le texte alors que le musicien, assis à sa gauche dans la même posture, accompagne son interprétation. L’engagement physique du tayû est si intense et si épuisant que plusieurs paires de récitants et musiciens se relayent au fil des tableaux et des actes. Pour faciliter ces transitions, l’estrade est montée sur un dispositif tournant. Certaines scènes, relativement peu fréquentes, demandent la présence de plusieurs tayû et musiciens. Les autres effets sonores sont produits par un bruiteur installé en coulisse ; occasionnellement, le shamisen est accompagné d’un koto (cithare à treize cordes) ou d’un autre instrument.
Le dispositif scénique
Le plateau du Théâtre national de Bunraku, Kokuritsu Bunraku Gekijô, que l’on peut considérer comme exemplaire, fait environ 12 mètres de largeur sur 4,5 mètres de profondeur. Il est divisé en trois parties dans le sens de la profondeur par des séparations en bois appelées tesuri. La première (environ 25 centimètres de haut) cache la rampe d’éclairage de l’avant-scène, qui n’est jamais utilisée comme aire de jeu et sert uniquement au machiniste qui tire le grand rideau latéral. Les deux autres séparations dissimulent le bas du corps des manipulateurs. Elles servent aussi à créer l’illusion que les poupées se déplaçant sur leur étroite rampe n’évoluent pas dans le vide. La deuxième séparation (environ 50 centimètres de haut) borde un espace de jeu d’environ 2 mètres de profondeur qui a la particularité d’être dans une sorte de fosse, une trentaine de centimètres plus bas que le niveau normal du plateau, d’où son nom de funazoko (fond de cale d’un bateau) ; cet espace est fermé côté cour et côté jardin par des rideaux d’où se font les entrées ; il est dépourvu de décor et réservé aux scènes d’extérieur. La troisième séparation (environ 85 centimètres de haut) marque l’aire de jeu qui occupe l’arrière du plateau, surtout utilisée pour les actions prenant place à l’intérieur des habitations, maisons, boutiques, temples ou palais. Décors et praticables sont accordés aux dimensions des poupées. Ils présentent, comme ceux du kabuki, des bâtiments ouverts en façade de façon à laisser voir les intérieurs. Au lointain, les toiles peintes, également dans le style plat et coloré du kabuki, situent le paysage ; dans certains cas, ces toiles peuvent se dérouler latéralement, créant ainsi des effets de déplacement alors que les poupées restent en fait sur place, mimant simplement leurs mouvements.
Les poupées
Pendant tout le XVIIe siècle, on utilisait pour les représentations théâtrales de petites poupées de 60 à 70 centimètres., tenues à bout de bras, mais la généralisation du système à trois manipulateurs, qui à partir des années 1730, entraîna un accroissement considérable de leur taille. Développée par le maître marionnettiste du Takemoto-za, Yoshida Bunzaburô, cette technique répartit la manipulation entre trois personnes : le maître (omozukai), juché sur de hautes socques de bois, contrôle de sa main gauche la tête, et de sa main droite, la main correspondante de la poupée ; le premier assistant (hidarizukai) s’occupe de la main gauche alors que le second assistant (ashizukai) fait mouvoir les pieds de la poupée. Si généralement les marionnettes sont manipulées par trois marionnettistes, il arrive qu’il n’y en ait qu’un seul pour les rôles mineurs. Ce système ne concerne que les rôles importants ; les figurants – soldats, gardes, serviteurs, passants, etc. – ainsi que les animaux sont animés par une seule personne. Les marionnettistes sont vêtus de noir, encagoulés, mais en fait, le maître se produit en général à visage découvert et apparaît souvent en tenue de cérémonie, semblable à celle du tayû. Il va sans dire que la maîtrise d’un tel système nécessite un long apprentissage, et la tradition parle de dix ans de pratique pour les pieds, suivis de dix pour le bras gauche, avant de pouvoir prétendre au statut de chef manipulateur !
Les poupées sont de grande taille (entre 90 et 140 centimètres.), surtout celles figurant des hommes, et peuvent, une fois habillées, peser de 4 à 5 kilos. Elles consistent en une tête de bois sculpté fixée au bout d’une tige qui prolonge le cou. Sur cette poignée sont insérés des petits leviers commandant les fils qui font bouger les éléments du visage de la poupée (les yeux, la bouche, les sourcils, voire la langue ou le nez), éléments que des ressorts en os de baleine ramènent à leur position de départ. Cette tige verticale passe par une structure en forme de portemanteau, rembourrée aux épaules, qui supporte le costume du personnage. Les membres de la poupée sont suspendus par des cordes à cette pièce d’épaule, alors qu’une structure légère, faite d’un épais papier tendu entre la pièce d’épaule et un cerceau de bambou à la taille, forme le tronc. La tige fixée à chaque bras est munie d’un taquet qui contrôle les ficelles permettant l’articulation des doigts, mais celle du bras gauche est beaucoup plus longue car l’assistant qui la manie est nécessairement plus éloigné. Le manipulateur meut les jambes des personnages masculins au moyen de crochets fixés à leurs talons, alors qu’il simule le mouvement des personnages féminins en remuant la traîne, alourdie, du kimono. Par ailleurs, il bruite de ses propres pieds la marche ou la course de la poupée. Si le rôle nécessite qu’un pied féminin soit visible, un membre indépendant est utilisé le moment venu. Il existe plusieurs sortes de mains et de pieds, plus ou moins sophistiqués en fonction des besoins du rôle. Mais le plus souvent, les accessoires – sabres, pipes, éventails, etc., – sont directement maniés par le marionnettiste dont la main reste dissimulée dans la manche du kimono de la poupée. Plutôt qu’à des personnages spécifiques, les têtes des poupées correspondent fondamentalement à des emplois, classés par âge, sexe et situation sociale – jeune premier, guerrier, vieillard, jeune femme, nourrice, etc. – et dédoublés entre « bons » et « mauvais ». Certaines têtes sont équipées pour autoriser des effets spectaculaires : visages se scindant en deux morceaux pour indiquer un rictus démoniaque, ou têtes fendues verticalement d’un grand coup de sabre. Les têtes sont laquées et coiffées de perruques très élaborées qui jouent un rôle majeur, car dans le Japon ancien, la coiffure permettait de situer immédiatement le rang et la situation sociale d’un personnage.
Répertoire
Le répertoire est fondamentalement celui du nouveau jôruri, qui commence à l’ère Genroku (1688-1704), ou un peu avant, à partir du moment où les chanteurs firent appel à des librettistes spécialisés, à l’instar de Takemoto Gidayû (1651-1714) commandant à Chikamatsu Monzaemon (1653-1724) des livrets rédigés spécifiquement pour son théâtre. Les dramaturges, qui commençaient alors à signer leurs textes, étaient directement rattachés aux troupes et travaillaient le plus souvent en collaboration, surtout pour les longs drames historiques, se répartissant les scènes en fonction de la hiérarchie interne à la « loge des écrivains » (sakusha-beya). Étonnamment productifs, les grands auteurs étaient en fait peu nombreux et l’essentiel du répertoire sort du pinceau de Chikamatsu et de ses successeurs immédiats, Takeda Izumo II (1691-1756, voir Takeda (famille)), Namiki Sôsuke (1695-1751), et enfin Chikamatsu Hanji (1725-1783), pratiquement le dernier dramaturge notable à travailler pour les poupées.
Comme dans le kabuki, on distingue entre les sewamono qui mettent en scène les gens ordinaires, le plus souvent des marchands et des courtisanes, et les jidaimono, pièces historiques qui présentent les hauts faits des guerriers et des nobles, prudemment situés dans des époques antérieures lorsqu’ils appartiennent au monde contemporain, les Tokugawa interdisant de mettre en scène des incidents impliquant la classe des guerriers de l’époque. Pour les premières, l’essentiel du répertoire est constitué par les vingt-quatre « tragédies bourgeoises » de Chikamatsu ; pour les secondes, les pièces les plus populaires et fréquemment reprises sont les grands drames historiques des années 1730-1760, comme Sugawara denju tenarai kagami (Modèle de calligraphie, la tradition secrète de Sugawara), Yoshitsune senbonzakura (Yoshitsune aux mille cerisiers) et Kanadehon Chûshingura (Le trésor des vassaux fidèles). Vu leur longueur, ces pièces sont rarement données dans leur intégralité, mais les actes les plus célèbres sont fréquemment joués. Comme au kabuki, les danses jouent un rôle majeur, qu’elles soient données en intermède ou insérées dans l’intrigue.
Actuellement, la seule formation professionnelle de bunraku est celle du Théâtre national de Bunraku d’Ôsaka, à laquelle on peut éventuellement ajouter le Théâtre de poupées d’Awaji, Awaji Ningyô-Za, qui en est stylistiquement assez proche.
(Voir Japon.)
Bibliographie
- Adachi, Barbara. Backstage at Bunraku. New York: Weatherhill, 1985.
- Japan Art Council. 2004. “Puppet Theatre of Japan: Bunraku”. http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/bunraku/en/. Accessed 3 May 2012.
- Keene, Donald. Bunraku. The Art of the Japanese Puppet Theatre. Tokyo: Kodansha International, 1965.
- Pimpaneau, Jacques. Fantômes manipulés. Le théâtre de poupées au Japon. Paris: Université Paris 7, Centre de publications Asie orientale, 1978.
- Sieffert, René, et Michel Wasserman. Arts du Japon. Théâtre classique. Paris: Maison des cultures du monde/POF, 1983.